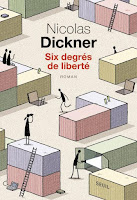Un fabuleux roman lumineux, truculent, dur et violent et très drôle !, qui sublime la lutte armée et acharnée de John Brown contre l'esclavagiste, le vieux Brown, un blanc Irlandais, au visage plein de rides et de sillons, abolitionniste jusqu'au bout des ongles, capitaine servant dans l'armée du Prince de la Paix. Un jeune esclave afro-américain, Henry Shackleford, fraîchement libéré, affublé d'un surnom ridicule l'Echalotte par le Vieux qui le prend pour une fille, raconte son enrôlement dans cette lutte aux côtés de cet énigmatique personnage, décrit les actions entreprises par son libérateur, des actions éminemment courageuses, qui deviennent de plus en plus violentes et qui se solderont par une insurrection violente et meurtrière, à Harpers Ferry, à laquelle aucun esclave ne se participera. Parce que «Pourquoi se battre pour sa liberté quand vous pouvez vous enfuir pour la gagner ?»
Une période de l'Histoire, certes romancée, mais décrite avec beaucoup de réalisme et d'humanité. Une écriture fluide, de belles descriptions, quelques répétitions parfois, qui peuvent agacer mais qui n'enlèvent rien à la grandeur de ce récit.
Une lecture pertinente et très instructive qui invite le lecteur à se faire une idée précise des conditions de vie des esclaves, de leur état d'esprit, de leurs peurs, de leurs craintes à s'engager dans une lutte abolitionniste, à engager leur vie, à quitter une zone de confort, relative, certes, mais néanmoins bien réel. «J'étais à nouveau esclave, c'est vrai, mais l'esclavage, c'est pas gênant quand vous avez eu votre mot à dire et une fois que vous vous y êtes habitué. Vous mangez à l’œil, vous avez un toit sur la tête gratuitement. C'est quelqu'un d'autre qui se casse la tête pour vous. C'était plus facile que d'être sur la piste, à éviter les bandes armées, à partager un écureuil rôti avec cinq autres types pendant que le Vieux s'adressait à Dieu et déblatérait sur ce truc rôti pendant une heure avant que vous puissiez toucher la bestiole, et, même à ce moment-là, il y avait pas assez de viande dessus pour boucher une petite partie du trou que vous aviez dans le ventre.»
Un bel hommage à ce grand homme, qui m'était totalement inconnu (j'ai honte), et à ses actions menées au péril de sa vie et de celles de ses fils engagés à ses côtés, pour accomplir sa mission, celle d'éradiquer l'esclavage. Un personnage hors du commun, un humaniste fanatique qui s'en remettait à Dieu, le rédempteur. «Les prières du Vieux, c'était du spectacle plus que du son, en fait, de la sensation plus que de la sensibilité. Il fallait être là : le fumet du faisan brûlé embaumant l'air, l'immense prairie du Kansas tout autour, l'odeur du crottin de bison, les moustiques et le vent qui cingle d'un côté, et de l'autre, lui qui mâchonne le vent.»
«Pour aider sa cause, il était capable d'inventer toute une histoire en quelques secondes. Il était comme tous ceux qui partent en guerre. Il croyait que Dieu était de son côté. Dans une guerre, tout le monde a Dieu de son côté. Le problème, c'est que Dieu, Lui, Il dit jamais à personne pour qui Il est.»
Un récit surprenant, haut en couleur, très prenant, dense, bourré d'actions, de rebondissements, de violence et d'humour.
Si Quentin Tarantino pouvait s'emparer de ce récit pour l'adapter sur grand écran, ce serait topissime !
«Il y a des choses dans ce monde qui sont tout simplement pas faites pour se produire,
pas au moment où on voudrait qu'elles se produisent,
et on doit les garder dans le cœur, le temps de notre passage dans ce monde,
comme un souvenir, une promesse pour le monde à venir.
Il y a une récompense au bout de tout ça,
mais quand même, c'est un sacré fardeau à porter.»
**********************
«Je suis né homme de couleur, surtout oubliez pas ça. Mais pendant dix-sept ans, j'ai vécu en me faisant passer pour une femme.
[...] le pionnier blanc ordinaire, il était pas insensible à la notion d'espoir. La plupart de ces gens-là était tombés à court de cette denrée récemment, vu qu'ils étaient venus dans l'Ouest poussés par un rêve qui s'était pas réalisé comme c'était écrit, alors tout ce qui pouvait les aider à se lever le matin pour exterminer des Indiens et pas passer l'arme à gauche, à cause d'une fièvre ou des serpents à sonnette, c'était un changement bienvenu.
Que ce soit la vérité vraie ou pas, ça n'avait pas d'importance pour lui. Il changeait tout simplement la vérité, jusqu'à ce qu'elle lui convienne. C'était un vrai homme blanc, quoi.
[...] mentir était une chose qui venait naturellement à tous les Noirs au temps de l'esclavage, car aucun homme ni aucune femme dans la servitude a jamais prospéré en étalant ses véritables pensées devant son patron. Une personne de couleur passait une bonne partie de sa vie à faire semblant, et les Noirs qui sciaient du bois sans rien dire étaient ceux qui vivaient le plus longtemps.
Au temps de l'esclavage, un Noir était un chien misérable, mais un chien qu'avait de la "valeur".
L'esclave ordinaire a besoin de liberté, pas de paroles. Le Noir a entendu des paroles d'appel au sens moral pendant deux cent ans. On ne peut plus attendre. Est-ce que Toussaint Louverture a attendu les Français à Haïti ? Est-ce que Spartacus a attendu le gouvernement romain ? Est-ce que Garibaldi a attendu les Génois ?
 |
Monts Allegheny (Virginie-Occidentale)
Spruce Knob, West |
 |
| Monts Allegheny (Virginie-Occidentale) |
 |
Monts Allegheny (Virginie-Occidentale)
Spruce Knob |
Un homme peut se cacher dans ces gorges pendant des années. Il y a du gibier. Plein de bois pour se construire un abri. Une armée forte de milliers d'hommes ne pourrait pas en déloger une petite troupe bien cachée. Dieu a posé Son pouce sur la terre et il a appuyé pour créer ces défilés pour les pauvres, l’Échalote. Je suis pas le premier à savoir ça. Spartacus, Toussaint Louverture, Garibaldi, ils le savaient tous. Ça a marché pour eux. Ils ont caché des milliers de soldats de cette manière. Dans ces tout petits défilés, des centaines de Noirs pourront se retrancher contre des milliers d'ennemis. La guerre de tranchées. Tu vois ?
Au bout d'une semaine de mon séjour, j'en avais par-dessus la tête de jouer à la fille, parce qu'une demoiselle, sur la piste, dans l'Ouest, elle pouvait cracher, chiquer, brailler, grogner et péter sans attirer plus d'attention sur elle qu'un oiseau qui picore des miettes de pain par terre. En fait, l'esclavagiste ordinaire trouvait même ce genre d'attitude carrément agréable chez une fille, vu qu'il y avait rien de mieux pour un gars dans les plaines que trouver une fille qui savait jouer aux cartes comme un homme et vider le fond d'une bouteille de whiskey à sa place quand il était bourré.
J'avais l'impression que la vie des Noirs, là-bas, elle était pas très différente de ce qu'elle était dans l'Ouest, à mon avis,. C'était comme un lynchage collectif, interminable. Tout le monde parvenait à faire un discours sur les Noirs, sauf les Noirs.
Etre un noir, ça veut dire montrer votre meilleur visage à l’homme blanc tous les jours. Vous connaissez ses désirs, ses besoins et vous l’observez comme il faut. Mais lui, il connaît pas vos désirs. Il connaît pas vos besoins, ni vos sentiments, ni ce qu’il y a en vous, parce que vous n’êtes pas son égal, en aucune façon. Pour lui, vous êtes rien qu’un nègre. Une chose, comme un chien, ou une pelle ou un cheval.»
**********************
Quatrième de couverture
En 1856, Henry Shackleford, douze ans, traîne avec insouciance sa condition de jeune esclave noir. Jusqu’à ce que le légendaire abolitionniste John Brown débarque en ville avec sa bande de renégats. Henry se retrouve alors libéré malgré lui et embarqué à la suite de ce chef illuminé qui le prend pour une fille. Affublé d’une robe et d’un bonnet, le jeune garçon sera brinquebalé des forêts où campent les révoltés aux salons des philanthropes en passant par les bordels de l’Ouest, traversant quelques-unes des heures les plus marquantes du XIXe siècle américain.
Dans cette épopée romanesque inventive et désopilante, récompensée par le prestigieux National Book Award en 2013, James McBride revisite avec un humour féroce et une verve truculente l’histoire de son pays et de l’un de ses héros les plus méconnus.
James McBride est né en 1957. Écrivain, scénariste, compositeur et musicien de jazz, il est saxophoniste au sein du groupe Rock Bottom Remainders. Il publie son premier livre en 1995, La Couleur d’une mère,un récit autobiographique devenu aujourd’hui un classique aux États-Unis. Son œuvre romanesque commencée en 2002 plonge au cœur de ses racines et de celles d’une Amérique qui n’a pas fini d’évoluer. L’Oiseau du Bon Dieu est son dernier roman.
À PROPOS DU LIVRE
L’Oiseau du Bon Dieu a remporté en 2013 le National Book Award, le plus prestigieux des prix littéraires américains et été élu Révélation étrangère de l'année 2015 par la rédaction du magazine Lire. Ce roman a également reçu le Prix des Lecteurs de La Librairie Nouvelle de Voiron en Isère.
Une adaptation cinématographique est en préparation.
Editions Gallmeister, août 2015
438 pages
Traduit de l'américain par François Happe
National Book Award